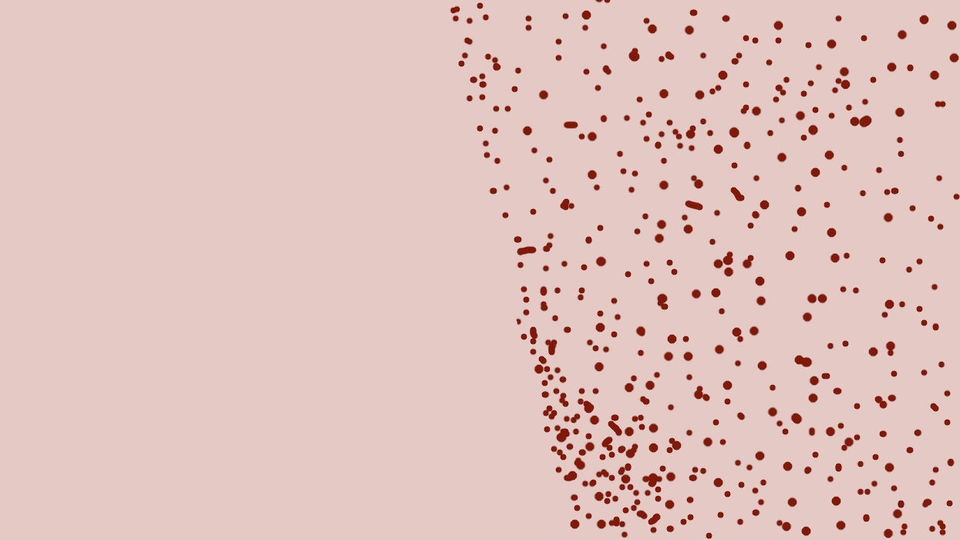Pansexuel, polyamour, métapartenaire… Le nouveau code amoureux
“Plutôt citadins, de milieux favorisés, des adolescents et de jeunes adultes ont confié à « M » leur vision de l’amour et de la sexualité, rejetant les frontières traditionnelles du genre, du couple ou du désir.
Puisque c’est le sujet, puisque le grand amour agonise, qu’il soit béni des poètes, de l’Eglise ou de l’Etat. A comme Adam, 25 ans, Parisien, chanteur ténor : « On vit une époque où on nous dit qu’on est libres de plein de choses, mais on a tendance à être paumés en raison de la pression de cette liberté et, du coup, à se raccrocher à des discours ou à des groupes. La liberté, à partir du moment où elle est fantasmée, s’éloigne de quelque chose de simple. C’est comme s’il fallait avoir une stratégie dès le réveil. »
A comme aujourd’hui et peut-être plus vraiment demain ? Ne surtout pas en déduire que ce chantier, ce remue-méninges ne dessinent qu’une passade. Ceux que nous avons rencontrés n’enfoncent aucune porte ouverte. Dans toutes ces histoires, les questions sont de toute façon plus importantes que les réponses.
Vera, 16 ans, les traits pâles et doux d’une gamine qui sort de l’enfance, rencontrée un samedi, chez ses parents à Cachan, près de Paris : « Les mots permettent de se mettre quelque part, de ne pas être complètement perdu. Ne pas mettre de mots, juste être, c’est génial ! Mais, pour nous, c’est une période confuse dans tous les domaines, alors les mots, ça nous aide, ça nous donne des repères. »
Ça monte au collège (voir C), comme une revendication, une parure ou une parade. « C’est alors très anarchique, parfois juste une blague ou juste un fantasme, l’idée que tout le monde peut être bisexuel », se souvient Adam du haut de ses 25 ans.
Eve et Alexander sont collégiens dans un établissement privé à Paris. Ils ont 14 ans, sont amis depuis tout petits, leurs parents sont cadres sup’ ou exercent des professions intellectuelles. Eve : « Là, maintenant, je sors avec un garçon, mais je crois que je ne l’aime plus, que je suis plus attirée par le corps des femmes. »
Alexander : « A un moment, quand on me disait gay, j’aimais pas ça, ça me rendait vulnérable. Maintenant, je montre que ça ne me fait pas mal, je l’assume. Mais il y a des fois où je préfère encore dire que je suis bi, surtout quand je suis avec des garçons. Les remarques homophobes, elles viennent des garçons, pas des filles. » Etre bi sonne chez elle comme de l’audace, chez lui comme une protection, une identité plus facile à porter que l’homosexualité. Etre bi, c’est parfois un passage.
Vera : « J’ai commencé à le sentir en quatrième. En troisième, je me disais bisexuelle, et maintenant je me sens lesbienne. Je suis encore en train de découvrir, ça change, je m’attribue plein de noms. C’est bizarre de dire que c’est une identité qui t’attire et en même temps que tu ne veux pas d’identité. Les normes, ça enferme, j’aimerais juste essayer des choses, être ce que je veux. » Grandir, c’est frotter les mots à la vie.
Jean, 20 ans, étudiant en chimie à la fac de Jussieu, se présente comme bisexuel et polyamoureux. Il a une amoureuse, des amantes et parfois des amants, lesquels connaissent donc l’existence des uns et des autres. « Il m’arrive d’être attiré par les hommes, mais j’ai du mal à m’entendre avec eux, ça se passe souvent moins bien qu’avec les femmes. Tout ce conditionnement… L’homme est très encadré… »
Adam, le plus avancé dans la vie, refait le parcours : « Avant la troisième, je flirtais avec les filles, mais j’avais un côté plus efféminé que mes potes et je sentais que la séduction avec les filles serait compliquée à cause de ça. Vers la troisième, pendant un voyage scolaire en Allemagne, je me suis dit que je pourrais flirter avec des mecs. Je me sentais bisexuel. Au lycée, ça devenait plus douloureux avec les filles. Pourquoi je trouve pas de nana, je suis pas assez viril ? C’est dur de ne pas être aimé parce qu’on n’est pas dans les codes dominants. Je ne l’ai accepté que récemment, c’est-à-dire des années après. »
« C’était pas les mêmes formes de désir, mais pendant un moment, oui, j’ai eu autant de désir pour les femmes que pour les hommes. Et les filles avec lesquelles j’ai eu des aventures sexuelles ou amoureuses étaient elles aussi bisexuelles. Puis, finalement, c’est devenu plus simple avec les mecs. Mais j’ai eu une copine il y a un an, ça a duré quatre mois. C’était très chouette, elle avait 19 ans, on parlait de s’installer ensemble. C’était plus des grandes idées que des choses réelles quand j’y repense… Ça a coincé finalement sur les questions d’identité : j’étais pas clair avec les mecs, elle savait mon ambivalence, au début ça l’a même intéressée, mais, très vite, elle s’est sentie menacée, elle a senti qu’elle pouvait pas gérer ça, elle m’a largué. »
Autant dire l’Ancien Régime. Papa et maman l’ont souvent fait voler en éclats, mais ils laissent à leurs enfants le spectacle d’adultes un peu paumés bien que plus libres que leurs propres parents.
Jean : « Mes parents sont restés mariés pendant vingt et un ans, ils ont divorcé il y a cinq ans, quand j’étais en seconde. Ils ne communiquaient pas entre eux, ne parlaient jamais de ce qu’ils ressentaient. Ma mère était étouffée, timide, elle avait rencontré mon père très jeune. Quand ils se sont séparés, j’ai vite compris que mes parents, c’était des adolescents, c’était lourd, ils se reprochaient des tas de choses. Ma sœur et moi, on a senti que c’était à nous de nous en occuper. Quand moi j’ai été en couple, c’était très fusionnel, mais étouffant, j’avais pas de temps pour moi. Le couple, ça bloque le développement de la pensée, ça laisse pas de place à l’individualité. Je m’empêchais de ressentir des choses pour d’autres, j’avais l’impression d’être un robot. »
Adam : « Quand mes parents ont divorcé, j’avais 5 ans, ça a forgé ma vision, la certitude que le bonheur personnel ne tient pas seulement par le couple. Tellement d’engueulades… Ensuite, mon père n’a jamais été stable avec une femme. Moi, j’ai jamais été trop longtemps en couple. L’idée de ce que ça devait être prenait le pas sur la relation. Je le cherche d’ailleurs moins qu’avant. Je n’ai plus cette peur de la solitude qu’ont tous les êtres. »
Eve : « Quand j’étais en CM2, mes parents ont divorcé, mon père est devenu homo. Ça n’a jamais été tabou. Ma sœur aînée est gay. Moi, je me pose encore des questions. » Elle se souvient d’une discussion, d’un garçon de sa classe qui a dit : « Ça doit être horrible d’être Eve, d’avoir une famille gay. » Elle n’était pourtant pas mécontente d’avoir troublé quelque chose dans la tête des autres : « Ça avait ouvert une grande discussion dans le car ! »
Alors C comme collège puisque c’est là que ça frémit. Adam : « Le collège, c’est là où tous les codes sont les plus installés. À cet âge, il faut avoir de la chance, faire les bonnes rencontres, celles qui vous aident à accepter vos fragilités. » C’est la chance d’Alexander d’avoir Eve et vice versa. C’est à elle qu’il en a parlé en premier.

« On était assis sur les escaliers en bois du collège. Y avait personne autour de nous. Je lui ai dit, Eve, je sais que tu t’en doutes, je suis gay. » Eve a gardé le secret. Et lorsqu’il l’a révélé publiquement à une fête, elle a ajouté comme pour l’épauler : « Moi aussi », même si elle n’en était pas sûre du tout. « Ce qui est drôle, ajoute-t-elle, c’est qu’en CM1 Alexander était amoureux de moi, il m’avait offert des gâteaux en forme de cœur. »
Quelle est la différence entre l’amour et l’amitié ? C’est une question que se posent souvent les polyamoureux qui veulent en finir avec « la monogamie toxique » et croient aux relations plurielles tant qu’elles sont transparentes. « J’ai cherché la différence, c’est pas une notion de degré, de désir, de non-désir, j’ai pas trouvé. J’ai même plus envie de savoir, j’ai envie d’aimer », répond de loin une jeune femme au Café de Paris, rue Oberkampf, dans le 11e arrondissement.
Nous sommes au « café poly » de Paris. Les polyamoureux s’y retrouvent le quatrième mardi de chaque mois. Jean m’a conseillé d’aller y faire un tour (le même genre de rendez-vous existe dans les grandes villes de province, selon le site Polyamour.info). Il a vu mon regard perdu lorsqu’il m’a confié devant sa tasse de thé vert : « Mon amoureuse, je me sens amoureux d’elle ; mon amante, je l’aime. Théoriquement, c’est la même chose, mais, pour moi, il y a un pas entre les deux. »
A priori, rue Oberkampf, c’est bière et grand écran les soirs de foot. Mais ça se passe dans l’arrière-salle. Les murs n’ont pas été rafraîchis depuis longtemps, ils sont encore tapissés d’un vieux tissu rouge, décorés de croûtes racontant Montmartre, suggérant une filiation avec les libres-penseurs d’un autre siècle. Ils sont plus de cent à l’intérieur. Une majorité a entre 20 et 30 ans, mais certains sont plus âgés.
« Le polyamour est-il un concept anarchiste ? », demande Jena, qui lit les questions écrites déposées dans une boîte en carton qui tourne et revient vers la scène où se tiennent les organisateurs du café poly. Une main se lève. Jérôme veut répondre : « Pourquoi pas. Il ne peut pas ne pas y avoir de règle. L’anarchie a des règles, elle n’a jamais été le chaos, comme on l’a trop dit. »
façon Zorro, telle Vera en classe : « En troisième, en cours de maths, j’entends un mec derrière moi qui demande à deux filles si elles sont lesbiennes. Je me retourne, et je lui dis : “Ça te dérange ? Parce que, moi, je le suis, enfin je suis bi, mais je suis attirée par les filles.” Ça a changé la classe. Je me suis sentie bien, j’ai aimé en parler. Un gars de la classe m’a dit après qu’il m’aimait pas trop, mais qu’il avait trouvé bien ma sortie. »
Le dire d’abord à sa mère, qui comprend souvent mieux, selon Jean le polyamoureux. « Ma mère, elle était curieuse, elle posait des questions. C’est chez elle que je vis, elle voit donc passer plusieurs de mes copines. Mon père, il trouve juste ça cool que j’ai plusieurs amoureuses, mais sur le mode macho : “C’est bien mon fils” ! »
Dire… ou ne pas dire. Vera se souvient d’une jeune fille qui lui souffla qu’elle aussi aimait les filles, qu’elle avait besoin de le partager avec quelqu’un, mais que ça devait rester ultrasecret. Dire est un privilège. Ceux qui parlent ici peuvent également le faire chez eux autour de la table de la cuisine. Mais ils rapportent d’autres mots chuchotés, comme ceux d’une jeune fille issue d’une famille musulmane et stricte qui rêve d’être un garçon. Est-ce que son corps réellement la démange ? Ou est-ce juste l’envie d’une peau où elle se sentirait plus libre ? Impossible de la rencontrer.
« Ma cousine me disait l’autre jour que, dans son collège, c’est la guerre des homos et des hétéros, raconte Eve. C’est peut-être un peu raciste de dire ça, mais c’est plus simple dans un collège de bobos. En tout cas, ça bouge partout ! A New York aussi ! » Sa cousine est juste d’un autre quartier parisien. « Partout » serait la somme des quartiers et des grandes villes du monde où s’immergent et émergent plus facilement les avant-gardes, les nouvelles vibrations culturelles et sexuelles. « Partout », parce que la mode, la musique, comme toujours les arts, ont déjà mis en avant ces identités volontairement troublantes.
Mais l’immense majorité des territoires reste traversée d’habitudes, de religions, de précarité, de frustrations et de tabous. Les repoussoirs traditionnels règnent encore sur les cours d’école, « Le pédé, la pute et l’ordre hétérosexuel », pour reprendre le titre de l’article de la sociologue Isabelle Clair publié en 2012 par la revue Agora, qui circule beaucoup depuis. Alors, reconnaît Jean, installé en terrasse pas loin de sa fac de Jussieu, « il faut du temps et se sentir en sécurité pour se poser toutes ces questions ».
C’est sûrement la limite, la pudeur de nos entretiens ou leur goût de la déconstruction, mais on entend davantage la réflexion que la pulsion.
« Le désir est plus sauvage, plus difficile à formuler, je ne sais pas à quel point je le sépare des sentiments, explique Adam. Moi, j’avais autant de désir pour les femmes que pour les hommes, puis, finalement, c’était plus animal, plus cru avec les hommes. Avec eux, rien de sacré, sûrement parce que j’ai peu d’espoir en l’homme, je n’attends rien, alors qu’avec les femmes ça se transformait en fantasme. C’est que ça s’est toujours mieux passé avec ma mère qu’avec mon père, et j’ai toujours écouté ma grand-mère, elle m’a inspiré. Tout ça transforme les femmes en saintes, ça me paralyse, l’acte sexuel devient une agression. Je le comprends maintenant, mais pas à l’époque. »
Le désir devient une forme d’engagement. Il n’est jamais question, à les écouter, d’un idéal fantasmé, d’un type d’homme ou de femme, d’un top-modèle, acteur ou actrice qui ferait rêver. Aucun critère physique. Ils refusent le modèle et le stigmate. Eve, vaguement repentante : « Moi, j’ai aimé un garçon un peu homophobe. » Alexander, assis à côté d’elle : « Elle était folle de lui. Il était aussi transphobe. » Eve : « Il disait des trucs qui paraissaient ahurissants. Je ne sais pas pourquoi, je l’ai bien aimé. » Alexander : « Elle l’aime encore. »
Eve, ses 14 ans, ses chamboulements. « Souvent, je me suis vue plus tard, avoir des relations avec des hommes, mais épouser une femme et avoir des enfants avec elle. »
E comme enfants. Sophie, entendue dans l’arrière-salle des polyamoureux : « On me dit souvent quand je parle de polyamour : “Mais tu veux des enfants ?” Cette question m’agace. La monogamie ne veut pas dire la stabilité. Je peux être poly et avoir une relation pendant vingt ans. C’est pas parce que j’aime d’autres gens que j’aime moins. »
F comme féministe
Mot clé revendiqué par tous. Filles et garçons. Mot qui contient à lui seul l’abolition de la domination masculine. Mot racine, donc. « Oh, oui ! », disent-ils.
Mot démodé quand ils sont nés, il y a plus ou moins vingt ans. Mot des soixante-huitards restés machistes. Mot qu’ils remettent sur le métier. « Ma sœur est très féministe. J’aime l’écouter me dire ce qui se passe, les injustices dont les filles sont victimes. Hier encore, dans un dîner, les mecs coupaient souvent la parole aux femmes. Je ne veux pas être dans le rôle de l’agresseur », dit Adam. Il cite une phrase du sketch si sombre et si drôle à la fois de Blanche Gardin La Première Fois : « Les hommes n’ont pas du tout conscience de cette violence qu’ils nous infligent dans la sexualité… »
Vera porte ce jour-là une petite jupe courte bleu marine, un carré sage châtain clair. « J’emprunte aussi beaucoup d’habits de mon père, j’ai eu les cheveux très courts, j’aime bien qu’on me prenne pour un garçon, j’aimerais jouer plus encore avec les codes. Je me sens parfois limitée dans le fait d’être juste une fille ou un garçon. »
Même son de cloche dans le café des polyamoureux : au moment de prendre la parole, on fait suivre son prénom ou son pseudo d’un pronom, « car il y a parmi nous des personnes comme moi qui ne veulent pas être assignées à un pronom ou à un accord », a prévenu d’entrée l’animatrice sous ses longs cheveux mauves. Ce soir-là, on pouvait entendre Marin (il et elle), Sophie (elle), Jade (il et elle) Olivier (il)…
Les doubles pronoms ne laissent pas forcément voir des transgenres. Le genre s’efface ou se déjoue. On provoque le système binaire et anatomique. On invente un troisième genre qui ne serait ni l’un ni l’autre ou l’un et l’autre. C’est la révolution ultime, celle d’une époque qui aurait achevé tous les grands soirs collectifs, et repoussé chacun vers lui-même et son miroir. Ils y mettent le sérieux, la raideur et la gravité de toutes les révolutions. Et alors, là ! pluie de mots en anglais puisque les Américains vont très vite dès qu’il s’agit de faire flamber la liberté individuelle.
G comme genderqueer, ou genre étrange, G comme gender-neutral, genre neutre, ou genderfluid, fluidité du genre… Un garçon hétérosexuel peut demander à ses amis de dire elle en parlant de lui. « Mais une fille devenue mec, enfin, transgenre, qui sort avec une fille, elle est bi ou lesbienne ? », demande Alexander. Ils s’y perdent aussi.
Ils adorent et téléchargent « RuPaul’s Drag Race ». RuPaul, drag-queen américaine qui a émergé dans les clubs new-yorkais des années 1990, en est à la dixième saison de son concours de drag-queens qui a commencé sur la chaîne LGBT Logo TV. Eve est une adepte. « Tout le monde regarde “Drag Race” ! Y a un gars dans le collège, il veut être drag-queen. Moi, des fois, je m’imagine en garçon. » Adam regarde aussi. « Depuis que Trump est passé, elle est devenue une figure de résistance. »
La déconstruction fait évidemment pâlir toute autorité. Eve : « Pour la fête de fin d’année au collège, l’an dernier, il fallait se déguiser sur le thème : représenter son pays. Nous, les filles, on est venues en Miss France et Alexander, il s’est mis en Miss America puisque sa mère est Américaine. » Alexander : « Ouais, j’étais en pute américaine, alors que tous les garçons étaient en footballeurs. Les profs n’ont pas aimé ça, j’ai eu une remarque quand on s’est mis à danser. Forcément, tu bouges les fesses… »
« Dans la communauté LGBT, être bisexuel, c’est mal vu, je discute avec certains, ils n’aiment pas nos histoires de bi et de polyamoureux », raconte Jean. Il fut un temps où la communauté gay eut besoin de se structurer, de s’afficher groupée pour affronter une société hostile, puis les ravages du sida. Elle regarde, circonspecte, le flou délibéré de cette fraction de la jeunesse actuelle qui ne parle quasiment plus de la maladie. Ils sont d’après.
« Les homosexuels ont eu besoin de se protéger, de dire clairement qu’ils étaient gays. De distribuer les rôles, les passifs, les actifs. C’est plus facile de se donner un rôle pour avoir une image précise de son identité. Dans la séduction, on vend quelque chose, il faut que l’image soit précise pour qu’on ne crée pas le flou chez l’autre », explique Adam qui se présente comme gay passif et bi.
ou métapartenaire. Chez les polyamoureux, c’est le ou l’un des partenaires de votre partenaire. Vous ne le connaissez pas forcément, mais vous connaissez son existence. Il peut être « éphémère » ou « permanent ». Il déclenche souvent la jalousie, c’est le grand sujet des polyamoureux qui ont grandi et vivent dans un monde qui n’en tolère qu’un.
Entendu dans l’arrière-salle du café polyamoureux. Luc : « Difficile de ne pas se sentir coupable de la jalousie des autres, même si ce n’est pas rationnel. » Louise : « La jalousie nous place dans une situation de grande insécurité, une perte, un abandon de l’enfance. Il faut retravailler ses blessures. » Paul : « Si Isa me dit : “Je t’aime, j’ai vu quelqu’un, je t’aime.” C’est beaucoup plus cool d’accepter un nouveau méta. » Stéphane : « Je suis un polyamoureux hiérarchique. J’ai besoin de sentir avec ma partenaire principale que j’ai une place particulière pour elle. Et, quand j’entre en relation avec quelqu’un, je dis clairement que je suis un polyamoureux hiérarchique, la personne doit savoir à quoi s’attendre. »
Pour en savoir plus, ils recommandent de lire La Salope éthique, publié en 1997 par deux Américaines, Dossie Easton et Janet W. Hardy, pionnières du polyamour.
Parce qu’au collège c’est « hypertendance » de se dire pan, raconte Eve. P comme pansexuel. « Ça veut dire tomber amoureux d’une personne quel que soit son genre », définit Jean (voir G).
« Mais, bon, c’est vrai que c’est comme bisexuel (voir B), reconnaît Eve, c’est juste plus branché de se dire pan. » « S’il n’y avait pas tant de codes, on serait beaucoup plus bisexuel. Si on basait nos vies sur l’échange, le plaisir… Nos pratiques sexuelles viennent de l’idée qu’on a de nous-mêmes et de l’image que les gens ont de nous », assure Adam. « Il y a plus de filles qui se disent pan, elles sont plus ouvertes », dit Alexander.
« Sur Insta, y a plein de gens de notre âge qui disent “Je suis pan” devant un drapeau LGBT », dit Eve. Sur Facebook, lu ceci, posté par une amie américaine sous la photo d’un couple garçon-fille d’environ 24 ans. « Voici Thomas, le premier petit copain de notre fille quand elle était en quatrième, et Rae, la première petite copine de notre fille, quand elle était en seconde. Ils ont vécu chez nous à différentes périodes et nous les avons toujours considérés comme nos enfants, même s’ils ont des parents épatants. Ils sont en couple depuis quelques années et vont se marier en novembre. On a hâte d’y être ! »
En introduction du café des polyamoureux, il est précisé : « cet espace n’est pas un espace de drague ». Ils sont là pour parler, partager, se confier. Les corps ne sont pas tendus, pas vêtus sur le mode séduction. On pourrait être dans un café philo.
Le sexe semble secondaire, même s’il est question de partenaires multiples. C’est comme s’il s’agissait plus de défier une norme que de jouir sans entraves. Ils sont tous avides de respect, de différence, de transparence. D’honnêteté. De consentement. Ici, comme à Nuit debout ou à Act Up, on applaudit dans le langage des signes en faisant les marionnettes. On peut même montrer sa solidarité ou sa compassion en joignant deux doigts au-dessus de sa tête.
Ils n’ont rien des libertins, ils sont plutôt des libertaires débarrassés de la tension militante et concentrés sur une sphère intime élargie. Leurs histoires multiples ne dessinent pas un tableau de chasse. Jean : « J’aime pas l’idée d’un rapport sexuel avec quelqu’un pour qui j’éprouve rien. J’en tire moins de plaisir. » Il est allé voir sur OkCupid, un site de rencontres où le profil de chacun est si précis que le site est très prisé des polys et des transgenres.
« J’y arrive pas. Je suis allé jusqu’au rendez-vous, mais j’ai compris que je ne pouvais pas avec des gens que je n’appréciais pas. Je conçois pas de partager des choses aussi intimes. Il y a cette idée de la performance sexuelle, surtout la première fois, ça m’angoisse beaucoup. Donc, le coup d’un soir, c’est pas pour moi. La virilité, c’est un concept que je ne comprends pas trop » (voir V).
Il flotte parmi tous ces mots qui ne veulent plus distinguer le il du elle, l’amitié de l’amour, l’amant de l’amant, des corps désirants mais pleins de raisonnement, presque sages finalement, dans un monde trop compétitif. Ils ne parlent jamais du porno, qui a pourtant pris une place considérable dans l’éveil sexuel de la majorité des jeunes. Ils fuient la performance et la domination. La sexualité ne tourne plus autour de la seule pénétration, elle devient à la fois plus libre et plus douce.
Vera, qui en parle tant, n’a rien connu encore : « J’ai toujours senti une urgence à me définir. J’aime avoir une attirance, m’approcher, mais après j’ai l’impression que ça diminue. Je me rends compte que, plus je m’approche, moins je suis intéressée. J’ai jamais eu d’histoire encore. »
Adam, le ténor, montre le bas de son ventre : « La voix vient des muscles, de leur contraction, ça commence au périnée, qui est aussi la zone du désir et du plaisir sexuel. Le chant fait vraiment accepter ce que je suis à un instant donné. Et ça fait aussi réfléchir sur la vie. Je ne dis pas “je veux arriver à telle note”. Chaque jour, je me lève, je me demande quel est l’état de mon corps, est-ce que ça va répondre ? Il faut être humble par rapport aux choses et aux plaisirs immédiats proposés. »
Mot honni ou porté disparu dans la bouche des personnes interrogées.”
Avec Le Monde…